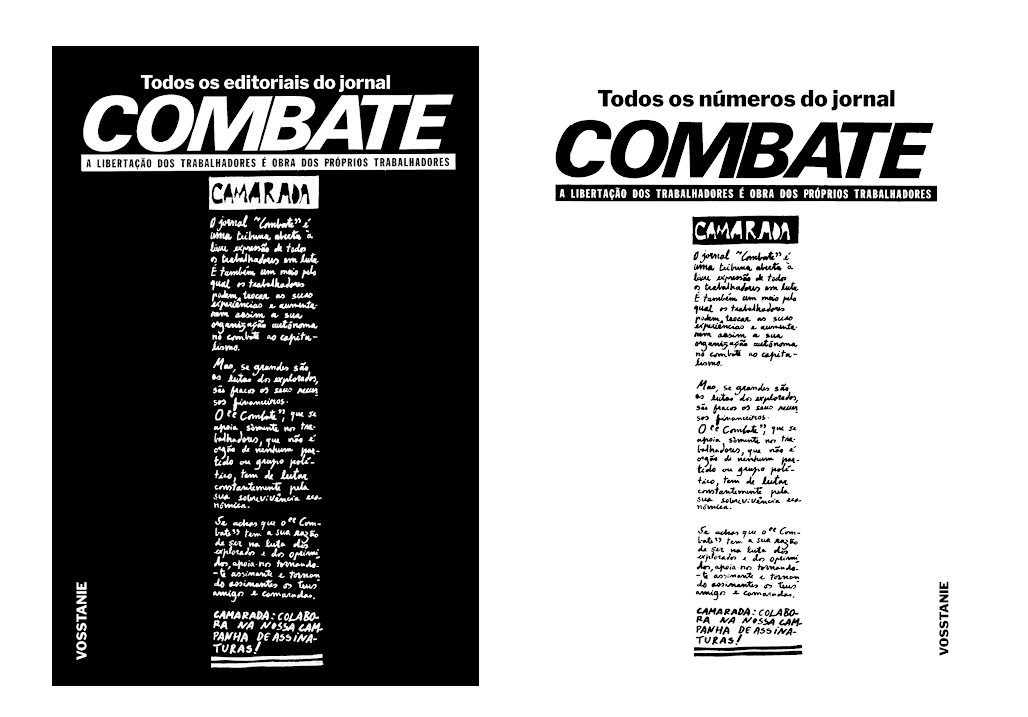Pratique, idéologie
et autonomie des travailleurs
et autonomie des travailleurs
REVUE RUPTURA (Brésil) 2009-2011 ?
ENTREVUE AVEC JOÃO BERNARDO
João Bernardo est portugais et il a une biographie [1] qui inclut son expulsion de l'université pour des raisons politiques et la participation au collectif qui a créé et animé le journal Combate à l'époque de la révolution portugaise. Aujourd'hui, il se distingue comme l'auteur de plusieurs ouvrages publiés au Portugal, au Brésil, en Espagne, aux États-Unis, en France, etc. Ses œuvres les plus connues sont: Pour
une théorie du Mode de production Communiste, Marx critique de Marx,
Crise de l'économie soviétique, Capital, Syndicats et Managers, Économie des conflits sociaux, Dialectique de la Pratique et de l'Idéologie, entre autres. Quelle est la question qui marque l'œuvre et l'entrevue avec João Bernardo ? C'est la question de l'autonomie des travailleurs. En ce sens, il s'agit de quelque chose qui nous intéresse. Depuis qu'a surgi le mouvement socialiste, son point de référence a généralement été la classe ouvrière, que cela soit pour s'appeler « l’avant-garde », soit pour être un simple spectateur de sa lutte, soit pour justifier le volontarisme, soit pour justifier le spontanéisme, deux extrêmes qui reflètent une « opposition binaire » pour reprendre l'expression du célèbre anthropologue, le plus démocratique (au sens bourgeois du terme) des sciences bourgeoises, Lévi-Strauss. Comme la bourgeoisie, qui va du romantisme à l'illuminisme, du rationalisme à l'irrationalisme, de la modernité à la postmodernité, de « l'objectivisme » au « subjectivisme » et ainsi de suite, on va d'un extrême à l'autre, même si ce sont les extrêmes de la même idéologie, celle de la bourgeoisie. Si le mouvement socialiste a pour point de départ la classe ouvrière, alors rien n'est plus juste que de partir de l'analyse de cette classe pour chercher à comprendre le processus révolutionnaire. Mais quelle que soit la vision de la classe et de la révolution, rien ne nous libère de l'obligation de penser à la manière dont nous nous insérons dans la réalité de la société capitaliste. Il y a deux positions par rapport à ce que devrait être un révolutionnaire: l'intérêt personnel ou le désintérêt pour la révolution. On ne peut être un authentique révolutionnaire si on s'en désintéresse, c'est-à-dire si cela l'est seulement par « pitié » pour les ouvriers, tout comme les philanthropes. On peut dire la même chose de ceux qui sont intéressés dans le sens que donne l'idéologie bourgeoise à l'idée « d'intérêt personnel ». Il est vrai que l'aliénation fondamentale est celle du travail, mais il n'en est pas moins vrai qu'elle s'étend à toutes les autres relations sociales et nous touche donc personnellement. Si, comme le disait Marx, le prolétariat, lorsqu'il se libère, libère toute l'humanité, c'est notre propre libération qui est en jeu, et cela signifie que nous ne pouvons pas nous exclure de la lutte et encore moins séparer la « vie privée » de la lutte de classe. Par conséquent, nous devons articuler nos luttes avec celles des travailleurs et, par-dessus tout, toujours nous battre. C'est une question éthique et existentielle, marquée par le refus de l'aliénation. Ne pas lutter, en fin de compte, signifie être d'accord avec le monde existant et servir à reproduire l'aliénation de la classe ouvrière et notre propre aliénation, ce que certains font sans le savoir. Ceci est d'autant plus nécessaire lorsque l'on a conscience que le résultat du processus n'est pas garanti, car dans ce cas, il faut chercher des moyens efficaces d'intervention pour influencer sur ce résultat. Toute pratique est politique et il n'y a donc pas de manques, mais seulement des pratiques conservatrices sous la justification du genre « ce n'est pas utile ». Bref, la lutte ouvrière est aussi notre lutte, car ce qui est en jeu, c'est la libération de la classe ouvrière et aussi notre libération. João Bernardo est-il d'accord avec ces thèses ? D'après ce que nous savons de lui, nous dirions qu'il est d'accord sur certains points et en désaccord sur d'autres. En attendant, il y a quelque chose de plus important que cela, il y a la lutte. Les réflexions de João Bernardo sont intéressantes et ouvrent un espace pour réfléchir à la révolution ouvrière sans avant-gardisme et, en oubliant les désaccords possibles, le travail de ce penseur est une riche collaboration au marxisme.
ENTREVUE
Ruptura: Le mode de production capitaliste entre dans une phase qui, selon beaucoup, sera marquée par une grande crise du capital. Comment la lutte ouvrière fait-elle face à cette nouvelle réalité ?
João Bernardo: Depuis que je suis politiquement actif depuis de nombreuses années, j'entends parler de la crise du capital, mais je vois le capitalisme se développer. Je ne comprends pas comment il peut y avoir une crise du capital sans avancée des travailleurs. Il semble unanime aujourd'hui qu'il y a un grand repli des travailleurs. Ils ont perdu une étape de luttes. Ce fut la dernière grande étape de combats. La fin de cette étape commence à la fin des années 50 et au début des années 60 en Europe et aux États-Unis, en ce qui concerne le mouvement noir, les droits civiques. C'était l'une des composantes d'un processus beaucoup plus long et complexe. La révolution culturelle chinoise est d'une importance énorme et c'est dans ce contexte que nous devons voir la guerre du Vietnam, et les derniers moments ont été le Portugal en 74 et 75 ; la Pologne de la
Solidarnosc [2], le Brésil de l'ABC [3].
Ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont les résultats d'une défaite dans cette phase de luttes. Le capitalisme d’État soviétique s'est désagrégé mais n'était pas dû à un quelconque processus révolutionnaire comme nous l'avons eu dans le cas de Solidarnosc en Pologne. C'est un autre indice à quel point la classe ouvrière aujourd'hui est désorganisée. Aujourd'hui, c'est le capital qui dicte les règles du jeu. Il organise la classe ouvrière presque comme il veut. Presque, cependant pas entièrement, comme le montrent les « nouvelles formes de gestion ». Les organisations ouvrières traditionnelles n'existent plus ou elles défendent le supra-classisme, etc., et les organisations syndicales lorsqu'elles ne défendent pas pleinement ces formes de gestion, tout ce qu'elles font c'est de négocier leur mise en œuvre. L'idée d'une lutte contre l'exploitation semble perdue par les organisations de classe et la classe localisée, je ne dis pas par les travailleurs, je ne dis pas dans la tête des travailleurs individuels, car nous ne savons pas ce qui se passe dans l'esprit de chacun. Ce que je vois aujourd'hui, c'est donc une avancée du capitalisme et un très grand recul des travailleurs. Il ne s'agit pas d'une crise du capital, bien au contraire. Maintenant qu'il y a des contradictions dans le capitalisme, c'est clair, c'est un processus, le capitalisme est contradictoire, donc il est clair qu'il y a contradiction.
En résumé, il me semble tout à fait erroné de confondre les contradictions avec la crise. Le capitalisme vit de sa capacité à récupérer, assimiler et reconvertir ses contradictions. La crise, c'est autre chose. Pour qu'il y ait crise, il faut qu'il y ait une classe offensive, dans un moment offensif.
Ruptura: On ne peut pas dire qu'il n'y a pas vraiment de développement du mouvement ouvrier, mais que ce serait latent et, dans ce sens, on pourrait dire qu'une nouvelle crise approche, qu'elle n'existe pas encore mais qu'elle est déjà en train de se dessiner ?
João Bernardo: Si, comme je l'ai dit, les processus sont contradictoires, alors la classe ouvrière répondra. Si elle obéit maintenant relativement bien à cette restructuration, après elle peut lutter contre cette restructuration. De quelle manière on ne sait pas encore. Ce qui me semble plus important aujourd'hui, c'est d'essayer de maintenir le plus de relations possible avec les luttes réelles, de comprendre quelles nouvelles formes sont générées dans ces luttes réelles, d'essayer d'établir des relations, d'unifier, d'entrer en contact entre nous. Bon, ce sont des objectifs très modestes, mais dans toutes les grandes phases du reflux, les objectifs sont modestes et pas complètement irréalistes. Je trouve préférable d'avoir des buts modestes que des buts utopiques, dans le mauvais sens du terme, paranoïaques, la folie des grandeurs.
Ruptura: Selon certains idéologues, la révolution technologique et la société de consommation produisent la fin de la classe ouvrière. De là, nous posons la question suivante : est-il possible que la fin de la classe ouvrière se produise dans le capitalisme ?
João Bernardo: Si nous avons assisté à un certain phénomène dans les dernières décennies, c'est l'expansion écrasante de la classe ouvrière, la prolétarisation des branches professionnelles qui n'étaient pas prolétaires auparavant. L'électronique a été largement utilisée à cette fin. Aujourd'hui, le commerce, du moins dans la plupart des pays, qui se faisait traditionnellement dans un contexte familial, est désormais totalement prolétarisé. Ce qui a disparu, ce n'est pas la classe ouvrière au sens marxiste, mais dans un sens sociologique, descriptif. En ce sens, sans aucun doute, la classe ouvrière a disparu. Cette classe ouvrière est une création relativement récente, datant de l'entre-deux-guerres. Avant il y avait un autre profil culturel de la classe ouvrière et avant cela, il y en avait un autre. Et chaque fois que cela arrive, les idéologues le disent.
S'il reste quelque chose du marxisme, à mon avis, c'est la théorie de l'exploitation. La théorie du pouvoir de Marx est dépassée et, à mon avis, ses théories de l'action politique révolutionnaire ont conduit à des résultats catastrophiques, mais la théorie de l'exploitation de Marx, la théorie de la plus-value relative et tout ce qui en découle, a été entièrement confirmée. Le modèle de la plus-value relative est le seul qui permette une analyse critique du développement du capitalisme. Le capitalisme de l'abondance signifie un nombre chaque fois plus grand ou est incorporé chaque fois mois de temps de travail. Plus grande est la qualification d'un travailleur, plus grande est son exploitation, car il produit un travail de plus en plus complexe. Par conséquent, une heure de son travail vaut de nombreuses heures de travail d'un docker de Manaus [4]. Bien, pour garder ce niveau de qualification on ne peut pas maintenir ce travailleur comme un docker de Manaus, vivant de misère et de cachaça. C'est cela qu'ils appellent la société de consommation. En fait, cela s'appelle extraire le maximum du travailleur et lui donner de plus en plus de produits avec de moins en moins de temps de travail. Nous parlons donc de la fin de la classe ouvrière, de la société des loisirs et d'autres choses du genre. C'est simplement journalistique et quand j'utilise le terme journalistique, ceci a un sens péjoratif.
Je conseille aux gens de ne pas lire la feuille de São Paulo, il vaut mieux lire la Gazeta Mercantil. Les gens disent que la Gazeta est ennuyeuse, or elle est ennuyeuse pour les gens qui ne la lisent pas. La Gazeta Mercantil ne dit pas que la classe ouvrière est finie, elle dit le contraire. Ça ne dit pas que l'exploitation est terminée, ça dit le contraire. Elle dit comment augmenter la productivité et c'est ce type de texte qui a un bon sens de classe. Les papiers de la FIESP [5] ne disent pas que la classe ouvrière est terminée. Lisez les idéologues de la gestion des entreprises. Je me souviens, il y a longtemps, d'avoir parlé en termes de temps de travail, de durée de temps de travail, et de voir de la part d'ex-marxistes des réactions très critiques: c'est quoi ça, le temps de travail ? Je n'ai même pas eu à me défendre, parce qu'un type de la gestion d'entreprise a fini par me défendre : « non, vous avez tout à fait raison, le temps de travail, c'est avec cela que le gestionnaire d'entreprise travail, le travailleur pour nous c'est du temps de travail ».
Ruptura: Alors cette thèse serait donc erronée, car elle partirait d'un point de vue descriptif, sociologique, et donc non-marxiste, qui définit la classe ouvrière dans son rapport au capital, qui est le rapport établi dans la production de plus-value.
João Bernardo: Le sens dans lequel je définis la classe est exclusivement celui-ci. Les classes, qu'elles soient conscientes ou non, résultent de ce processus. Avez-vous déjà imaginé ce que c'est de faire une médecine basée sur la conscience. Si une personne n'avait pas réalisé qu'elle avait un cancer, elle n'aurait pas eu de cancer. « Ah, tu avais un cancer », « comment, ce n'est pas possible, je n'en avais pas conscience ». Les classes évoluent, qu'elles en aient ou non conscience. La conscience, pour moi, ne vaut pas grand-chose. Et quand on dit que le processus de la lutte des classes doit être conscient ? Il s'achève comme étant le résultat de ce que nous avons déjà fait. L'idéologie est une réflexion toujours a posteriori sur une pratique que nous avons faite. C'est le grand dilemme de l'être humain. Nous agissons dans l'obscurité et puis nous réfléchissons, c'est-à-dire que nous réfléchissons sur les choses matérielles et les choses matérielles sont la pratique que nous avons faite, nous réfléchissons toujours sur les pratiques que nous avons déjà faites.
Pourquoi la classe ouvrière devrait-elle avoir un profil culturel unique ? Il peut y avoir une classe ouvrière aux profils culturels multiples. Pourquoi pas, si des relations de solidarité peuvent exister avec d'autres profils culturels. D'ailleurs, c'est ce qui existe encore entre nous. Si nous avons une base pratique qui dépasse ces différences de formation et que cette base pratique se fait dans les luttes des travailleurs, alors que vous avez un système de gestion capitaliste, qui consiste à créer une multiplicité de profils culturels pour diviser la classe, et la lutte des travailleurs, qui consiste à réunir, reconstruire et rétablir la solidarité, malgré ces profils culturels différents.
Ruptura: Il y a là un problème qui peut être soulevé ici : si l'autogestion présuppose le contrôle de l'être humain sur les forces productives, de la nature, ce qui signifie l’auto -gouvernement ou la planification autogérée de la société, ne serait-il pas nécessaire d'avoir une conscience et dans ce cas ne cesserait-elle pas d'avoir une importance secondaire et deviendrait d’une importance fondamentale ?
João Bernardo: Je pourrais même dire oui, mais l'expérience... Je suis un idéologue de profession, mais un idéologue de l'idéologie plus incrédule que vous pouvez l'imaginer. Je pense que nous sommes forcés de nous agréger à une idéologie. L'homme, l'être humain, ne vit pas sans elle. Mais je ne crois pas aux aspects pratiques de l'idéologie. J'ai écrit un livre qui a été édité ici au Brésil, par Cortêz, et au Portugal, par Afrontamento, qui s'appelle Dialectique de la Pratique et de l’Idéologie et c'est là que j'entends, entre autres, dire ceci : l'idéologie est inefficace. Bien, je vais prendre un exemple. Vous parlez d'autogestion comme principe politique. Je n'ai vu l'autogestion que directement, au Portugal, en 74 et 75. La première entreprise au Portugal qui s'est lancée dans l'autogestion a produit trois mille pièces de vêtements et comptait huit femmes. Il s'agissait essentiellement d'une entreprise étrangère et avait dans sa ligne une partie couture. Pourquoi sont-elles rentrées en autogestion ? Parce que l'administrateur étranger a tout bloqué et s'est enfui avec l'argent de l'entreprise. Mais, bien sûr, il a laissé là-bas une montagne de vêtements. Alors puisqu'elles devaient survivre, elles ont commencé à coudre et à continuer à vendre. C'est pour cela qu'elles ont assumé une conscience révolutionnaire. Quand elles ont réalisé ce qu'elles faisaient, c'est-à-dire seulement après ce moment-là. C'étaient des femmes qui n'avaient jamais lutté auparavant.
La deuxième entreprise qui est rentrée en autogestion était aussi de couture, mais celle-là était une entreprise nationale. Avec la dictature, le patron s'est enfui au Brésil, à cette époque sous le gouvernement de Garrastazu Médici [6] qui était ici et tous ces gens ont fui ici. Il s'est enfui avec l'argent et elles produisaient et toutes les autres qui sont entrées dans le processus d'autogestion l'ont rarement fait avec des présupposés idéologiques. Ils sont passés à l'autogestion parce que les types s'enfuyaient toujours. À l'époque, j'ai eu une dispute avec un dirigeant d'un groupuscule international qui s'opposait à l'autogestion et qui croyait que l'autogestion c'était l'aliénation des travailleurs. J'ai dit : « Eh bien, les ouvriers doivent vivre, n'est-ce pas ? ils doivent manger d'une façon ou d'une autre, ils ne peuvent pas vivre des droits d'auteur de livres qui critiquent l'autogestion. Ce type a dit : « Ils devraient braquer les supermarchés ». Je lui ai répondu : « Savez-vous que les principales chaines de supermarchés sont en autogestion ? » et c'était vrai, alors ils feraient quoi, se voler les uns les autres. Telle était la réalité des faits. Après l'avoir fait, et c'est ce qui a été spectaculaire au Portugal en 74 et 75, ce qui a été pour moi une expérience inoubliable, bien que j'eusse rompu avec le léninisme à cette époque, j'ai continué avec cette idée que la révolution allait surgir des grandes concentrations ouvrières.
Ces femmes et ces entreprises sans passé de lutte ont remodelé leurs relations de travail, reformulé le lien entre l'ensemble des travailleurs non qualifiés et mal payés et les encadrements internes, restructuré les hiérarchies, remodelé le système des employés de bureau et commencé à passer par la chaine de production, des choses comme ça. Et ce qui était vraiment prodigieux, merveilleux, c'était de voir ces gens prendre conscience de ce qu'ils avaient fait et d'être capables de faire quelque chose de révolutionnaire. C'est là qu'elles ont pris conscience et c'est ainsi que le processus d'autogestion s'est déroulé. Donc, bien sûr, quand elles assument cette conscience, elles se radicalisent, mais il me semble que c'est déjà le cours naturel du processus.
Rupture: J'ai lu votre livre Dialectique de la pratique et de l'idéologie et je me suis retrouvé à douter sur la façon dont, dans votre conception, le changement survient. Dans ce cas, selon vous, le changement vient de la pratique et dans un second moment la conscience finit par avoir un rôle, qui serait de renforcer cette nouvelle pratique.
João Bernardo: Dans ce livre, si je me souviens bien, la conscience sert à mettre les gens en contact. Ces derniers, une fois en contact, peuvent faciliter les unifications et les luttes ultérieures. Cela me semble plus important que le modèle que je propose ou ce que je vous dis. C'est beaucoup plus important que le contenu idéologique qui peut être diffusé. Mettez de côté la Dialectique de la pratique et de l'idéologie et prenez le cas des femmes au Portugal. Au Portugal, à l'époque de Salazar, les femmes étaient plus opprimées qu'elles ne le sont habituellement, de sorte que les expériences de luttes étaient presque l'affaire des hommes. Les femmes qui vendaient du poisson, je ne sais pas pourquoi, étaient des femmes très actives, mais les autres étaient très soumises, par leur propre mari. Avez-vous déjà imaginé que ces femmes occupaient les usines, les installations, se relayaient, y passaient la nuit. Elle arrivait et disait : « Aujourd'hui, c'est mon jour de dormir à l'usine ». Savez-vous ce que cela signifiait pour le mari ouvrier traditionnel, très traditionnel ? Lorsque nous les avons interviewées, elles nous ont dit : « Heureusement, nos maris nous ont beaucoup aidées ». Eh bien, il y avait le personnel des usines aux environs et les maris allaient là-bas pour les surveiller, mais ils ne pouvaient tout simplement pas le dire, ils avaient besoin de créer des stratégies et ensuite ils disaient qu'ils allaient là-bas pour les aider. Malgré cela, elles allaient beaucoup plus loin dans ce processus de transformation, survenant sur le site de production et touchant la famille. Je l'ai vu et je peux vous garantir qu'il existe. Bien, quand je lis ou entends quelqu'un dire que la société ne peut pas changer, je dis : elle peut changer et j'ai vu cet exemple.
Une fois, en parlant avec une amie, qui avait aussi vécu cette période de luttes, j'ai critiqué des groupes d'une certaine façon comme vous, pas vous, mais d'autres. Ils avaient une vision purement littéraire du processus d'autogestion, comme une nouvelle théorie qui émerge. Je lui ai demandé : « Quel est votre point de vue sur le processus ? » « Des personnes qui sont nées après la fin de cette vague de combats ». Elle m'a répondu : « C'est déjà beaucoup d'avoir cette vision livresque ». Mais c'est quelque chose que ceux qui ont vécu ne peuvent pas transmettre, que les gens peuvent transmettre sous forme littéraire une fois de plus, que vous assimilez sous forme littéraire. Mais ce que vous pouvez vivre est bien plus riche que ce qu'une personne peut dire. Une pratique est beaucoup plus multiforme et nous avons vu des transformations effectives et je souligne cet aspect d'avoir émergé, ces transformations, dans des lieux où il n'y avait pas de traditions, de gens qui n'avaient jamais combattu. Sûrement qu'ils s'étaient battus dans leur vie privée, on ne peut jamais dire que les gens ne se sont pas battus, mais qu'ils se sont battus d'une manière, enfin, aliénée. Nous dirions, pas si aliénés que cela, parce qu'ils étaient capables de donner une réponse et ils furent ceux qui ont le plus enduré la lutte par la suite.
C'est ainsi que je vois un mouvement autonome. On ne peut pas penser qu'un mouvement autonome puisse surgir d'une action si planifiée que cela, car il est vraiment autonome, il nous dépasse.
Ruptura: Bien, maintenant nous devons faire la défense du groupe. Vous dites vous-même que toute « idéologie » découle d'une pratique et vous dites ensuite qu'il a des groupes, comme le MSL [7], qui auraient une conception purement livresque de l'autogestion. N'y a-t-il pas là une contradiction ? Après tout, pourquoi prendrions-nous cette culture du livre et l'accepterions-nous ? Ne serait-elle pas également une pratique ? En ce sens, on peut dire qu'il s'agit d'une pratique différente, une autre pratique. Cette critique ressemble à une critique qui m'a été adressée par des léninistes (certains, aujourd'hui, ex-léninistes) qui m'ont accusé de défendre des idées d'auto-organisation pour ne pas avoir une « pratique ». Quelle était cette pratique ? De toute évidence, c'est leur pratique.
João Bernardo: Vous avez tout à fait raison. Mais j'ai fait une autocritique. Je l'ai fait lorsque j'ai raconté que ma critique avait été réfutée par une camarade. Et bien sûr, votre vision du processus autogestionnaire, produite dans une situation de reflux de la classe ouvrière, doit être différente. Et a été le résultat de votre pratique, votre pratique, sans aucun doute. Maintenant, ce que je veux dire, c'est ceci : je ne dis pas que ma pratique a été plus importante que la vôtre. Ma pratique m'a permis d'avoir une vision donnée du processus autogestionnaire et autonome. Vous avez une autre pratique, qu'elle est la plus appropriée, la mienne ou la vôtre ? Je dirais, peut-être, dans la mesure où nous vivons dans une situation de grand reflux, votre pratique est la plus appropriée.
Maintenant une chose que nous devons prendre en considération, le léniniste, le stalinien, sans parler des autres, a un objectif, il a l'intention d'encadrer la réalité et tout ce qui sort du modèle qu'il entend désarticuler, détruire et les techniques léninistes et staliniennes pour désarticuler la réalité sociale sur laquelle le Parti ne peut avoir de contrôle est une technique extrêmement élaborée, elle existe et porte toujours ses fruits pour ceux qui la pratique. Il est nécessaire que le mouvement soit très fort pour dépasser tout cela. Bien, alors, nous devrons faire de même et c'est un grand risque lorsqu'un groupe se forme autour d'une plate-forme idéologique. Il y a le risque que vous deveniez aveugle à une pratique qui n'entre pas dans votre plateforme idéologique. Comment est-ce que l'on dépasse cela ? Je ne sais pas, car si les reflux sont précisément les moments pour les séparations, pour les divisions. Je dirais que créer une revue plus de choc, de confrontation, plus critique, d'avoir des gens de courants différents qui acceptent de s’affronter et de se confronter tout en respectant les règles du jeu démocratiques C'est presque aussi utopique que n'importe quoi d'autre.
Ce sont donc les limites des situations de reflux, tout contribue à la désagrégation. On se rassemble autour de quoi ? Il y a une pratique commune, mais c'est le problème, dans une situation de reflux il n'y a pas de pratiques aussi fortes, donc on se rassemble autour d'une plateforme idéologique. Il y a là un inconvénient : soit vous vous disloquez, ou au moins la personne court un sérieux risque d'être aveugle à ce qui est extérieur à la plate-forme idéologique. Comment une personne sort-elle de cette situation ? Je ne sais pas, c'est une contradiction que nous devons vivre.
Ruptura: Le contenu du socialisme c'est l'autogestion. Cependant, les expériences diverses et courtes d'autogestion ont été vaincues par le capital. Aujourd'hui, le mode de production capitaliste, en même temps qu'il fait preuve de force, démontre ses faiblesses. Quelles sont les perspectives de l'autogestion dans ce cadre historique marqué par l'ambigüité ?
João Bernardo: Écoutez, je ne sais pas. J’espère ne pas faire partie de ces gens qui meurent en disant : « Je meurs, mais je suis certain ». Il y a un poète portugais (...), qui raconte l'histoire d'un type qui, après s'être fait tirer dessus, a dit : « attention ! La prochaine fois que vous me tirez dessus, laissez-moi au moins le temps de mourir en criant : Vive la Révolution ! ». Les perspectives sont les suivantes : je ne vois pas la possibilité de démontrer qu'au capitalisme succèdera inévitablement une société sans classes. Malheureusement, Marx a confondu cette grande concentration du capital avec le socialisme. Le plus qu'on puisse dire, avec les pieds sur terre, c'est qu'il existe dans le capitalisme des conditions formidables pour surmonter la société de classes, mais je pense que ce sera un processus très long, de plusieurs siècles. Je ne pense pas que la classe ouvrière renversera rapidement le capital. Elle réussira à avancer et, dans ces cycles de reprise, avance la récupération de la classe ouvrière par le capital, et chaque fois que la classe ouvrière fait une nouvelle avancée, elle le fera sur le terrain récupéré par le capital. Regardez les grands cycles révolutionnaires de 1848, puis la Commune de Paris, les grandes luttes de 16 à 21, puis les luttes autonomes. Vous commencez à le voir avant 48 jusqu'à la révolution culturelle et Solidarnosc en Pologne. La lutte de 1848 semble même enfantine au vu des revendications et des problématiques qu'elles posèrent. La lutte devient de plus en plus profonde, non pas comme un cercle vicieux, mais comme une spirale croissante.
Nous pouvons constater également que le capitalisme a des contradictions et ne peut vivre que de l'exploitation et que les gens lutteront contre l'exploitation. Mais en même temps, nous avons des divisions et si les travailleurs parviennent à surmonter ces divisions, les capitalistes réussiront à les obliger à de nouvelles divisions. Le grand problème pour moi, est à l'intérieur de la classe ouvrière. C'est le problème central, le problème de la réorganisation au sein de la classe ouvrière.
Je me suis souvent demandé comment il était possible d'avoir un mouvement autonome au Portugal pendant 74/75 de cette amplitude. Nous sortions de 48 ans de fascisme. Le fascisme avait tout désorganisé. Vous ne pouvez pas imaginer à quoi ressemblait la répression au Portugal, non pas qu'il y ait eu de la police, des tortures comme celles en Argentine. Il y avait de la torture et la police, mais là n'est pas la question : c'était une répression morale à un point invraisemblable. Il était interdit de s'embrasser en public. Eh bien, c'était des choses incroyables. Comment ce mouvement a-t-il été possible ? La classe ouvrière n'avait pas le droit de s'organiser politiquement, elle n'avait pas le droit de s'exprimer, de faire grève, d'avoir ses syndicats propres. Elle a constitué des mécanismes défensifs, dans les quartiers, dans les bars, dans les associations populaires et récréatives et nous, marxistes, maoïstes, léninistes les appelions aliénés, parce qu'ils ne voulaient pas de politique et ils avaient absolument raison de ne pas en vouloir, c'était la condition pour leur survie. On y allait et on faisait notre boulot, on recrutait, et les gars ne voulaient pas qu'on le fasse. Et ils avaient raison stratégiquement, ils créaient des mécanismes défensifs, et ce sont ces mécanismes qui leur ont permis de créer rapidement des commissions de quartier. Au Brésil, c'était la même chose pendant la dictature militaire, elle désorganisait les usines et les gens s'organisaient dans les quartiers. Vous avez remarqué que le mouvement de l'ABC vient après que les militaires ont physiquement et idéologiquement exterminé toute une génération de militants, avec l'extermination de ces gars qui ont été créés du temps de Vargas à Goulart, les nouveaux gars, les jeunes trotskistes, les catholiques. C'est la classe elle-même qui a fait ce mouvement. C'est le signe qu'il s'agit de garanties, de signes très sérieux d'une poursuite d'un processus révolutionnaire. Vous savez comment on appelle un type qui ne se bat que quand il sait qu'il va gagner ? C'est un lâche.
Nous nous battons historiquement et nous devons nous battre sans garantie de gagner. C'est ce qui rend le processus intéressant, avec une garantie cela ne vaut pas la peine, mais avec des indications sérieuses pour ne pas être complètement paranoïaque. Vous vivez dans un pays qui a, par exemple, un mouvement syndical, sans parler des universités, avec des contradictions si grandes que vous pouvez y travailler. Ce n'est pas un hasard si le mouvement ouvrier ici a encore une force. Les syndicats ne sont pas moins bureaucratiques au Brésil que partout ailleurs, mais les pressions des travailleurs sont si fortes que les syndicats doivent céder à cette demande, tout comme les universités. Ce n'est pas parce qu'ils veulent le faire, c'est parce qu'ils doivent le faire. Ce sont donc des espaces d'organisation dont vous profitez et dont vous devez profiter et qui sont exemplaires pour nous. Au Brésil, on croit souvent que l'Europe est un exemple. L'Europe n'est pas un exemple sinon celui de la vieillesse.
Traduction Vosstanie - Juillet 2019.
Extrait de Era um mundo de João Bernardo, Vosstanie Éditions (2019).
NOTES
[1]
Pour en savoir plus sur son
parcours et l’expérience du Journal Combate :
Émission du 13 septembre 2014 de Radio Vosstanie.
[2]
Parfois appelé Solidarité
en français, est une fédération de syndicats polonais fondée le
31 août 1980, dirigée à l'origine par Lech Wałęsa. Dans les
années 1980, ce mouvement joue un rôle clé dans l'opposition au
régime de la République populaire de Pologne.
[3].
En 1979, dans la région ABC de São Paulo, plus de 150000
métallurgistes en grève affrontent le gouvernement militaire afin
d’obtenir de meilleures conditions de vie.
[4]
Capitale de l'État de l'Amazonas, dans le nord-ouest du Brésil.
[5]
FIESP – Fédération des Industries de L'État de São Paulo
[6]
Emílio Garrastazu Médici a été président de la République
Brésilienne du 30 octobre 1969 au 15 mars 1974. Médici
représentait la frange la plus dure du Régime militaire, au
pouvoir depuis le coup d’État de 1964.
[7]
Ancien nom du Movaut
- Movimento Autogestionário.
L'abréviation signifie Movimento
Socialista Libertário, il est le
deuxième nom du collectif, car le premier était le Movimento
Conselhista.